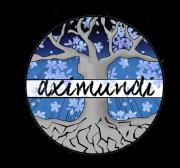Qu'est-ce que l'hypnose ?
L’hypnose constitue un état de veille paradoxale où le sujet se retire plus ou moins profondément de l’environnement et fonctionne ainsi dans un nouveau rapport avec celui-ci. Ce changement d'orientation à la réalité se manifeste au travers d’une absorption et d’un lâcher-prise propice à une réorganisation du fonctionnement psychique. La transe hypnotique correspond à un état psychophysiologique caractéristique qui se traduit par une réorganisation temporaire du fonctionnement psychique sur un plan cognitif, émotionnel et temporel. Cette transe est labile, dynamique et se modifie constamment selon les sujets et les séances ; cette variation est souvent d’ordre subjectif et traduit en cela un mode de fonctionnement spécifique à chacun. Il est, en ce sens, difficile d’en définir le contenu. Toutefois, les descriptions faites par les patients peuvent nous orienter dans la compréhension de ce type de vécu. A ce jour, il semble certain qu’il n’existe pas une hypnose mais un ensemble de transes dont la qualité peut aller de la simple rêverie au somnambulisme complet avec une totale amnésie spontanée au réveil.
L’hypnose, telle qu’elle est pratiquée dans cette recherche, s’apparente à une profonde relaxation dont il est possible de différencier différentes transes. Michaux (1982), en collaboration avec Chertok, repère deux types de comportements hypnotiques qui paraissent enracinés dans les mécanismes élémentaires de la vie adaptative : la transe immobile ou cataleptique et la transe mobile ou somnambulique. L’auteur met en évidence quatre formes de comportement hypnotique. Dans la forme « somnambulique », le sujet manifeste à la fois une activité de type éveillée (théâtralisme) et une modification de l’état de conscience s’apparentant au sommeil. Le corps semble soumis aux dires de l’autre ; c’est l’espace même de la suggestibilité. Dans la forme « pseudo-léthargique », la conscience est modifiée et une grande passivité vient limiter la suggestibilité du sujet. Dans la forme « cataleptique », l’état de conscience s’accompagne d’une inhibition des capacités d’expression verbale (mutisme) et d’un maintien du tonus musculaire supérieur à la normal. Enfin, dans la forme dite de « léthargie-réveil » ou encore « paradoxale », le sujet présente à la fois une hypotonie musculaire et une activité importante de la conscience du type veille. La suggestibilité est généralement élevée. Les deux premières formes se présentent comme fusionnelles : les sujets acceptent la relation à l’autre, soit en tenant un rôle actif comme dans le « somnambulisme », soit en tenant le rôle passif d’objets de soins (« pseudo-léthargie »). Les deux dernières formes d’hypnose se présentent au contraire comme moyens de défense dans la relation à l’autre : submissivité et immobilisation tonique pour la forme « cataleptique », absence physique jointe à une conscience défensive dans la forme « léthargie-réveil ». Ces formes hypnotiques se traduisent par une passivité tonique et une activité imaginative prépondérante. Ces deux traits favorisent à la fois un espace maternant qui renforce l’ego par identification au thérapeute (introjection) ainsi que la possibilité de travailler sur l’imaginaire qui est à la base de la constitution de notre singularité.
Enfin, soulignons que l’isolation psychosensorielle nécessaire à l’induction hypnotique entraîne une levée des mécanismes de contrôle et une libération facilitée d’éléments inconscients sous la forme d’une activité imaginaire qui peut aller de la simple rêverie jusqu’à l’hallucination. Ce fonctionnement centripète facilite un relâchement associatif qui modifie la structure même de l’organisation des représentations. L’hypnose permet alors de vivre au sein d’un espace psychique plus souple, une forme de liberté intérieure et extérieure où l’Autre n’a plus sa place d’agresseur réelle ou symbolique et où sa vision du monde peut être modifiée sous l’effet même de l’expérience hypnotique. Cette approche est alors dite « découvrante » car elle s’appuie sur une maïeutique hypnotique.
Retour page Psychologie & Psychothérapie