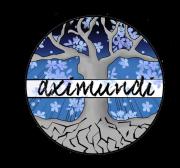Integral Somatic Psychotherapy (ISP)
L’ISP est un modèle psychothérapique conçu par Selvam (2015) issu de la Somatic Experiencing et de la psychologie orientale. Cette approche souligne la nécessité de travailler avec le corps puisque tous les processus psychiques (pensées, émotions, imagination) sont liés aux processus physiologiques. Influencé par l’Orient, ce modèle envisage également les aspects spirituels propres à la culture indienne : psychologie orientale, yoga, théorie des chakras, principes de polarité.
Le but essentiel de l’ISP est de travailler sur la souffrance (et non pas sur une idée de réalisation personnelle) en augmentant le vécu corporel et en favorisant une régulation qui s’amorce spontanément dès que le sujet se situe dans les conditions propices. Selvam propose d’appeler « personnification » (« embodiment ») ce qui doit être recherché en psychothérapie : une capacité à vivre davantage son corps. La personnification passe par quatre étapes à engager en consultation :
Générer une expérience : Travailler sur un plan somatique l’émotion de base de l’expérience. Pour chaque souvenir « désagréable», il est possible de repérer une émotion fondamentale parmi les émotions émergentes. Certaines émotions activées peuvent constituer des mécanismes adaptatifs de résistance (MAR) et travailler avec elles serait entretenir les MAR, empêchant toute assimilation complète du souvenir. Le patient est donc continuellement incité à focaliser son attention (« pleine conscience focalisée », Grand, 2013) sur cette émotion de base, en particulier sur les zones du corps où celle-ci s’exprime.
Tolérer cette expérience : Cette seconde phase vise à favoriser une acceptation du vécu somatique et émotionnel. Tolérer l’émotion et le ressenti est d’ordre confrontatif : C’est rompre avec cette tendance légitime à isoler la souffrance et à la repousser. Tolérer permet de générer davantage (phase 1), de mieux posséder cette expérience, diminuer l’intolérance et en conséquence réduire le dérèglement physiologique. Ceci doit se faire en respectant la fenêtre de tolérance du patient.
Donner du sens à cette expérience : Mieux ressentir ses vécus internes permet progressivement de mettre des mots, de nommer et contextualiser. Cette mise en sens s’effectue chez l’enfant grâce aux interactions avec les parents en particulier. Elle s’opère dans le cadre thérapeutique avec le thérapeute via le système d’engagement social. L’impossibilité de mettre du sens rend un vécu intolérable. Tolérer l’émotion et le vécu somatique amène naturellement, souvent spontanément, du sens à ce qui émerge de soi, en soi.
Agir en fonction de cette expérience : Vivre pleinement son expérience permet d’être en accord avec soi-même, en cohérence avec ce que l’on est, avec ses désirs et du coup d’agir verbalement et/ou physiquement efficacement, aboutissant à une gestalt complète. Le faire face est alors efficace, l’intégrité n’est plus menacée, l’homéostasie possible.
En ISP, l’objectif est donc de générer l’expérience vécue autant que possible dans le corps et le cerveau, respecter la tolérance du sujet, prendre en compte les résistances innées et acquises afin d’agir sur la pensée et les comportements. Les patients qui ne peuvent générer l’émotion présentent des difficultés à agir efficacement et à mettre du sens. Les pathologies mentales sont souvent en effet liées à cette intolérance émotionnelle.
Selvam préconise l’utilisation de trois principales techniques :
La Pleine conscience focalisée : focaliser son attention sur le vécu corporel en lien avec l’émotion de base, attendre, observer ce vers quoi cela nous mène, laisser faire. Cela se rapproche du Vipassana, forme de méditation où l’attention se porte sur le corps (Huguelit, 2003).
Le toucher : il est demandé au consultant de poser sa main sur la zone du corps activée et d’observer ce qui va se modifier au niveau des sensations. Les mains peuvent être également posées sur deux zones du corps spécifiques afin d’étendre l’expansion en suivant par exemple des directions précises.
Le mouvement : proposer au patient d’effectuer certains mouvements permet de relier diverses zones du corps. Par exemple, chez un patient ayant des difficultés à penser ses ressentis, mobiliser le cou facilite une extension de la poitrine vers la tête. Chaque zone du corps comporte une symbolique susceptible. La mobilisation de certaines parties du corps judicieusement choisies oriente le travail thérapeutique et favorise une régulation. Pour exemple, tendre les bras, poings fermés avec les paumes orientées vers le bas et ouvrir les mains tend à aider à lâcher quelque chose, à laisser partir.
Vous pourrez avoir plus d'informations sur le site de R. Selvam en cliquant ici.
V